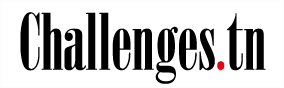Hédi Sraieb : Pouvoir d’achat «une stricte mesure monétaire, est incapable de restituer la qualité de la vie»
Face à la course poursuite salaire-prix, Hédi Sraieb, Docteur d’Etat en Economie du développement, pense que le gouvernement ne dispose pas de véritables marges de manœuvre pour améliorer le pouvoir d’achat des citoyens. Dans un entretien accordé à l’agence TAP, il estime que seule une négociation tripartite entre les partenaires sociaux, sur des questions autres que la seule variable salariale, telles que le cadre de vie, l’accès à un logement décent, à une éducation, à la culture, aux soins, à des loisirs de qualité…, pourrait marquer le début d’une solution.
Les dernières statistiques de l’INS faisant état d’un recul de la pauvreté en Tunisie, ont suscité une grande polémique. Quelle analyse faites-vous de ces statistiques ?
La statistique est l’outil privilégié du calcul économique, lequel est souvent à la base de la prise de décision politique. Autrement dit une statistique n’est jamais véritablement neutre. S’agissant de la pauvreté absolue ou relative, les définitions retenues par l’INS sont celles des principales institutions internationales. Elle mesure cette pauvreté selon une unité monétaire (moins de 1$ par jour et par foyer). La pauvreté est donc d’abord monétaire autrement dit mesurée en pouvoir d’achat. On peut bien évidement contester cette approche. Car à regarder de plus près, on peut aisément affirmer qu’être «pauvre en ville» est bien plus difficile qu’être «pauvre à la campagne». On pourrait ainsi, multiplier les angles d’approche, tout en continuant à accepter cette seule mesure monétaire. La pauvreté d’un groupe familial uni et en bonne santé, est bien différente de celle d’une famille avec un parent malade et un enfant au chômage. L’inconvénient majeur de cette mesure strictement monétaire, c’est qu’elle occulte d’autres aspects de l’existence humaine. En d’autres termes, une stricte mesure monétaire est incapable de restituer la qualité de la vie. Cette mesure ne dit rien de l’accès à une éducation, à des soins. Elle ne dit rien de la détresse affective, elle-même résultant de conditions matérielles «indignes».
En outre, la polémique que vous évoquez provient du procédé lui-même utilisé par l’INS. L’institut procède par sondage, et non pas par une mesure mensuelle et exhaustive des « nécessiteux » qui bénéficient de l’allocation (de l’ordre de 250 DT en moyenne). L’INS mesure invariablement, le même nombre de pauvres depuis plusieurs semestres, autour de 15%. La pauvreté absolue n’aurait pas non plus changée. L’enquête de consommation réalisée en 2015-2016 n’observe étonnamment, aucun changement notable, par rapport à celle réalisée en 2010. Une fois encore, cela semble dû à la méthode pratique mise en œuvre (questionnaire, panel). Ce qui semble véritablement regrettable dans l’approche de l’INS, c’est que celle-ci ne cherche pas approcher « la précarité », l’autre terme pour désigner la pauvreté au 21e siècle, par d’autres méthodes, d’autres éclairages: l’accès à un logement décent, l’accès à une éducation et à la culture, à des loisirs de qualité.
Quelles sont selon vous, les raisons profondes derrière la détérioration du pouvoir d’achat du tunisien ?
C’est un phénomène quasi invisible, quasi imperceptible, car il se déroule sur le long terme. Il s’agit de ce que les économistes appellent l’illusion monétaire. En effet, la feuille de paie laisse transparaitre une progression constante. Bon an, mal an, tout un chacun obtient des augmentations, au niveau du salaire direct ou des primes. Mais voilà; le véritable pouvoir d’achat ne progresse pas voire régresse du fait que les prix de leur côté augmentent également, et dans bien des cas plus rapidement que ces hausses de salaires. Comme nous pouvons le constater, l’indice général des prix ne reflète que très imparfaitement l’évolution générale des prix.
L’illusion provient du fait que l’on ne ressent pas la désindexation des salaires par rapport aux prix. Ainsi et pour prendre un exemple, il est facile de vérifier que le pouvoir d’achat d’un douanier, d’un agent de police, d’une institutrice a considérablement diminué par rapport à ce qu’il pouvait être dans les années 70 ou 90.
Il est tout à fait regrettable que l’UGTT ne se soit pas emparée de cette question cruciale de la définition et de la composition interne de l’indice des prix. Mais à l’évidence, les citoyens ne sont pas dupes, ils constatent régulièrement le décalage entre l’indice publié par l’INS et les étiquettes sur les produits …quand ce n’est pas le coût du logement, des transports, de la santé et de l’éducation. Une sorte de jeu de dupes semble d’ailleurs, s’être installé. C’est un cercle infernal, d’un côté, les syndicats ouvriers revendiquent des augmentations arguant du besoin de rattrapage de l’inflation. De l’autre, les entreprises ajustent à leur tour, leurs prix à la hausse pour conserver les mêmes marges du fait du renchérissement relatif de leurs coûts.
Quelles pistes (ou politiques) devraient être favorisées pour stopper cette détérioration ?
De toute évidence, les salariés sont, certes à des degrés divers, toujours perdants. Leurs salaires ne suivent pas le coût réel de la vie. Avec la marchandisation de nouvelles d’activités, telles que la santé ou l’éducation, les ménages doivent désormais faire face à des dépenses qui étaient pour l’essentiel et auparavant réduites voire insignifiantes. Les frais de scolarisation comme les coûts des soins et des médicaments ont pour ainsi dire explosé…alors qu’ils étaient réduits dans les décennies antérieures.
Tout ce dont il est question ces derniers temps est la nécessité d’une « pause salariale ». Outre le gel des salaires autant dans le secteur public que celui du privé, le gouvernement envisage la réduction du nombre des fonctionnaires. Le chiffre de 50 000 de départs volontaires en retraite anticipée, est avancé.
Il s’agit autant dire, d’un coup de frein possible à la spirale salaires-prix que nous connaissons depuis déjà quelques temps, ce qui dans un contexte de croissance atone, a contribué à aggraver les déséquilibres. Entendons-nous bien, les salaires ne sont pas en tant que tels responsables de la crise des finances publiques. En l’absence de croissance et donc d’augmentation mécanique des rentrées fiscales, la masse salariale du secteur public a cru plus vite (de 11 milliards de dinars en 2010 à 14 milliards de dinars en 2016) que les recettes budgétaires … Il y va sans doute de manière similaire, dans le secteur privé, même si ne disposons pas de données statistiques, où probablement la masse salariale s’est accrue dans la valeur ajoutée, réduisant d’autant les marges des entreprises. D’où aussi l’une des raisons possibles parmi d’autres, du fléchissement des investissements privés.
Face à cette course poursuite salaire-prix, le gouvernement ne dispose pas de véritables marges de manœuvre. Il peut tenter de passer en force et se heurter au refus des syndicats et attiser par-là, la colère populaire. Un pari osé, dans un contexte où la moindre étincelle peut se transformer en explosion sociale. Le gouvernement peut aussi, tenter une négociation tripartite.
Le changement récent de direction à la tête de l’UGTT pourrait être propice à un élargissement de la négociation. J’entends par là sur d’autres questions que la seule variable salariale.
Les partenaires sociaux sont-ils capables de trouver un accord autour d’une modération salariale qui aurait pour contrepartie des créations d’emplois. J’ai bien conscience que ce type de compromis est difficile à trouver compte tenu des traditions anciennes dans le domaine des relations sociales et professionnelles. Les deux organisations syndicale et patronale ne se retrouvent que pour discuter des augmentations de salaires, rarement d’autres choses ! Rien n’est joué à ce stade. Nous n’en sommes qu’aux premiers rounds d’observation !
TAP