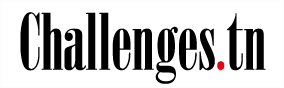Politiquement indépendant, le ministre de la Justice n’a pas manqué de faire entendre sa différence sur une série de sujets sensibles. Et a fini par en faire les frais.
On ne dit pas non à son chef. C’est pourtant ce qu’a fait le ministre tunisien de la Justice, Mohamed Salah Ben Aïssa, 67 ans, limogé dans la foulée par le chef du gouvernement, Habib Essid, le 20 octobre. Le différend qui opposait les deux hommes portait sur la constitutionnalité de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature. Droit dans ses bottes, l’ancien doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, réputé pour sa probité et son indépendance, n’a jamais manqué de faire entendre sa différence, se prononçant pour la dépénalisation de l’homosexualité et contre la loi sur la réconciliation économique voulue par le chef de l’État. Des prises de position qui ont détonné dans un contexte dominé par le consensus. Et finalement coûté son poste à l’intéressé.
JA : Pourquoi avez-vous été limogé ?
Mohamed Salah Ben Aïssa : Principalement à cause d’un différend avec le chef de l’exécutif portant sur le projet de loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, que j’avais élaboré en conformité avec la Constitution et que le gouvernement avait endossé, puis transmis à l’Assemblée des représentants du peuple [ARP] pour adoption. Mais la Commission de législation générale de l’ARP a décidé de produire – et de faire voter – un nouveau texte que j’ai jugé anticonstitutionnel, car il ne garantit pas l’indépendance du pouvoir judiciaire, comme l’a également constaté l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, qui a rejeté neuf des articles, soulignant que le projet soumis par le gouvernement avait été vidé de sa substance.
Pour rappel, l’initiative législative revient soit au gouvernement, soit à un groupe de dix députés, soit au président de la République. La Commission peut modifier ou ajuster un projet, mais elle ne peut en aucun cas le dénaturer. Les articles jugés inconstitutionnels ont été corrigés, mais, sur le point relatif à l’âme du texte, la réponse a été la suivante : « Nous sommes les représentants de la nation et exerçons le pouvoir législatif. Aucune autorité n’a le droit de limiter nos prérogatives. » Une manière de rejeter l’avis d’une instance de contrôle dont le rôle est essentiel.
Vous aviez donc obtenu gain de cause ?
Mon seul souci était d’œuvrer au respect de la Constitution. Le projet revu et corrigé m’a bien été transmis par la présidence de l’ARP pour avis. Avant de lui répondre, j’en ai référé au chef du gouvernement en soulignant que le point concernant la substance du texte avait été occulté. Il est resté vague, tout en précisant que l’intérêt général du pays lui importait. Puis il a adressé, sans m’en avoir informé, un courrier au président de l’ARP dans lequel il déclare que le projet remodelé est conforme à celui du gouvernement et à ses objectifs !
Or je persistais à penser que le projet n’était pas totalement conforme à la décision de l’instance de contrôle et de ce fait non conforme à la Constitution. En le soutenant devant les élus, je me serais discrédité ; en exposant mon opinion, je n’aurais pas représenté la position de l’exécutif. J’ai donc refusé de participer à la séance parlementaire consacrée à l’examen du projet de loi, d’où mon limogeage immédiat
Le paradoxe est que Béji Caïd Essebsi avait soutenu qu’un ministre qui n’a pas la force de défendre ses projets de loi n’a pas sa place dans le gouvernement
Avez-vous l’impression d’avoir été lâché par le président de la République, Béji Caïd Essebsi ?
Ses déclarations confirment qu’il n’a pas apprécié ma position ; j’avais refusé d’obtempérer aux ordres de mon supérieur. Le paradoxe est que Béji Caïd Essebsi avait soutenu qu’un ministre qui n’a pas la force de défendre ses projets de loi n’a pas sa place dans le gouvernement. Or c’est exactement ce que j’ai fait. Manifestement, le chef de l’État n’avait pas une connaissance parfaite du dossier. Mais j’avais déjà un passif, puisque j’ai affirmé que la loi de 2013 sur la justice transitionnelle était largement suffisante en matière de conciliation et d’arbitrage dans les affaires de corruption, et que la loi organique sur la réconciliation nationale voulue par le chef de l’État n’avait pas lieu d’être.
 J’ai aussi eu le tort de me prononcer, au nom du respect, inscrit dans la Constitution, des libertés individuelles et de la vie privée, en faveur d’une éventuelle abrogation de l’article 230 pénalisant l’homosexualité. Selon le président, un membre du gouvernement doit, au nom du « sens de l’État », s’abstenir d’émettre ses propres opinions. Ce qui est éminemment contestable.
J’ai aussi eu le tort de me prononcer, au nom du respect, inscrit dans la Constitution, des libertés individuelles et de la vie privée, en faveur d’une éventuelle abrogation de l’article 230 pénalisant l’homosexualité. Selon le président, un membre du gouvernement doit, au nom du « sens de l’État », s’abstenir d’émettre ses propres opinions. Ce qui est éminemment contestable.
Votre éviction suscite de multiples interrogations sur le fonctionnement du gouvernement.
Si l’attitude du Premier ministre a été abusive, je reste sincèrement convaincu que le gouvernement a réussi à améliorer globalement la situation au vu de celle dont il a hérité. C’est au moment de sa composition que le bât a blessé. Deux partis avaient raflé la mise aux législatives, mais aucun ne pouvait gouverner seul. Or, paradoxalement, le chef du gouvernement désigné n’appartient à aucune des deux formations. Cela signifie que le parti majoritaire n’a trouvé l’homme idoine qu’en dehors de ses rangs : un homme non encarté qui connaît le système et qui a fait ses preuves en tant que ministre de l’Intérieur. Mais il doit composer avec des ministres qui affichent leur couleur politique. Sa position est délicate.
Dans ce cas, quel est le statut des ministres réellement indépendants ? Pourquoi sont-ils là ? Ne sont-ils pas censés apporter quelque chose de spécifique et d’inédit qui ne correspond pas toujours à l’orientation globale du gouvernement ? On a donc des ministres partisans et les autres, ceux qui ont été proches de l’ancien régime et les indépendants. Il y a là comme une malformation congénitale. La crise autour du Conseil supérieur de la magistrature en est la preuve.
La machine judiciaire est archaïque. Plus de la moitié du budget, près de 500 millions de dinars, est affectée aux salaires
On vous reproche une certaine lenteur dans la mise en place des réformes de la justice.
L’infrastructure humaine est insuffisante. Dans toutes les juridictions, le nombre de magistrats et de greffiers est bien en deçà de celui qui permettrait de traiter normalement les affaires. La qualité de la justice s’en ressent. La formation a pâti de la conjoncture de 2012-2013. Prévue sur deux ans, sa durée a été réduite de moitié pour compenser le manque de magistrats. Son contenu est également à revoir, tout comme il est nécessaire de revoir la carte judiciaire pour rapprocher la justice du citoyen. Il ne suffit pas de faire des décrets, il faut avoir des moyens financiers et humains.
La machine judiciaire est archaïque. Plus de la moitié du budget, près de 500 millions de dinars, est affectée aux salaires. Après une révolution, on établit normalement les responsabilités et on apure des situations. Or rien n’a été fait dans ce sens ; tout fonctionne encore avec les anciens. Le ministre de la Justice est surtout celui du parquet. Les nominations, mutations et promotions sont encore du ressort de l’Instance provisoire de supervision de la justice… créée en 2013.
Des jihadistes arrêtés puis relâchés, du laxisme dans l’instruction de l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaïd… Jusqu’à quel point un ministre de la Justice peut-il intervenir ?
Sur le dossier de Chokri Belaïd, aucune défaillance dans le travail du juge d’instruction n’a été constatée par l’inspection générale. Actuellement, une autre procédure est en cours. J’ai présenté, en tant que chef du parquet, via le procureur général de la cour d’appel, une série de demandes auxquelles le juge est sommé de répondre. Concernant les jihadistes, la question est sérieuse et relève d’un problème de coordination technique et de méthode de travail dans les enquêtes policières.
Que retenez-vous de votre expérience au gouvernement ?
Le décalage entre les objectifs de la révolution du 14 janvier et ceux de la coalition au pouvoir. C’est le trait marquant de la transition politique en cours. Je ne regrette pas d’avoir tout mis en œuvre pour que les projets de loi élaborés sous l’égide du ministère de la Justice soient conformes à la Constitution. De ce point de vue, j’ai la conscience tranquille. Mon refus d’assister à la séance parlementaire pour le vote du projet de loi sur le Conseil supérieur de la magistrature était une question de principe. Ma dignité était en jeu. Je ne pouvais accepter de perdre mon âme et mon indépendance, et, in fine, me dissoudre dans des calculs politiciens qui m’étaient totalement étrangers.
Frida Dahmani