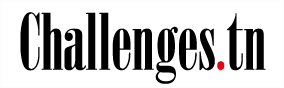La transition énergétique mondiale, propulsée par l’urgence climatique et exacerbée par les récentes instabilités géopolitiques, notamment le conflit en Ukraine, a propulsé les minerais critiques au rang de ressources stratégiques incontournables. Des éléments tels que le lithium, le cobalt, le cuivre et les terres rares, fondamentaux pour la fabrication des batteries des véhicules électriques et le développement des infrastructures énergétiques vertes, sont désormais au centre des stratégies industrielles à l’échelle internationale.
La concentration géographique significative de ces ressources, avec la Chine comme acteur dominant dans le raffinage et la transformation, intensifie les tensions économiques globales et incite les puissances occidentales à activement diversifier leurs sources d’approvisionnement.
Dans ce contexte géopolitique et économique en pleine mutation, l’Afrique se positionne comme un acteur d’une importance capitale au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale des minerais critiques. Le continent africain recèle environ 30 % des réserves mondiales de ces minerais essentiels à la concrétisation de la transition énergétique. Des nations telles que la République Démocratique du Congo (RDC), qui détient à elle seule 73 % des ressources mondiales de cobalt, ainsi que l’Afrique du Sud, le Burundi et la Tanzanie, riches en gisements de terres rares, possèdent un levier économique considérable susceptible de redéfinir les équilibres mondiaux.
Cependant, cette abondance naturelle de ressources demeure en grande partie sous-exploitée ou exportée à l’état brut. Cette pratique prive les économies africaines d’une part significative de la valeur ajoutée potentielle. En République Démocratique du Congo, par exemple, le cuivre et le cobalt représentent une part substantielle de l’économie, contribuant à hauteur de 40 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Paradoxalement, des ressources tout aussi cruciales pour la fabrication des batteries, telles que le graphite ou le manganèse, ne représentent qu’une faible proportion de l’activité économique, soit environ 5 % du PIB.
Face à cette réalité et conscients du potentiel inexploité, plusieurs nations africaines ont initié des réformes structurelles visant à renforcer leur attractivité auprès des investisseurs internationaux. La mise en place de régimes fiscaux incitatifs, l’amélioration de la sécurité juridique des investissements et la promotion de partenariats public-privé constituent des mesures clés pour attirer les capitaux étrangers. L’ambition clairement affichée est de transcender un modèle économique principalement extractif pour évoluer vers une industrie intégrée, capable de raffiner les minerais sur place et de produire localement des composants essentiels pour les chaînes de valeur mondiales.
Des initiatives concrètes se manifestent à travers l’étude et la planification de projets de construction d’usines de raffinage et d’unités de fabrication de batteries dans divers pays du continent. À terme, la réalisation de ces projets pourrait significativement renforcer la compétitivité de l’Afrique sur la scène internationale, générer des opportunités d’emploi qualifié, assurer des revenus plus stables et réduire la vulnérabilité des économies africaines aux fluctuations des cours mondiaux des matières premières.
Néanmoins, la concrétisation de cette ambition se heurte à des obstacles structurels majeurs. Le déficit criant en infrastructures énergétiques constitue un frein considérable au développement de projets industriels de grande envergure, tout comme l’insuffisance et la vétusté des réseaux de transport. Ces lacunes logistiques, associées à une forte dépendance à un nombre limité de minerais, exposent les économies africaines à une vulnérabilité accrue face aux chocs économiques externes.
De surcroît, des enjeux environnementaux et sociaux d’une importance capitale doivent être adressés avec rigueur. La pollution des sols et des eaux, la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre et les conditions de travail précaires, parfois marquées par le recours au travail des enfants, représentent des défis majeurs. Ces problématiques exigent une régulation stricte et une gouvernance responsable afin de garantir la durabilité et l’éthique des projets miniers.
Malgré ces défis persistants, une dynamique continentale positive et des partenariats géoéconomiques prometteurs sont en cours de développement. Des synergies régionales commencent à émerger, à l’image de l’accord stratégique signé entre la Zambie et la RDC visant à développer une filière intégrée de batteries électriques. Selon les estimations de Benchmark Minerals, huit nouvelles mines de terres rares devraient entrer en production sur le continent africain d’ici 2029, permettant à l’Afrique d’assurer jusqu’à 9 % de l’approvisionnement mondial de ces minerais critiques.
Parallèlement, l’Union européenne intensifie ses efforts pour établir des protocoles d’accords avec les nations africaines riches en ressources, dans le but de sécuriser ses propres chaînes d’approvisionnement en dehors de la dépendance à la Chine. Bruxelles a également lancé 47 projets miniers sur son propre territoire, tout en renforçant activement sa coopération stratégique avec les pays africains dotés de ressources minérales critiques.
Pour l’Afrique, le moment est crucial. La valorisation stratégique de ses ressources minérales critiques représente une opportunité historique de transformation économique profonde. À condition de privilégier la montée en gamme industrielle, la transparence dans la gestion des ressources, la diversification économique et une coopération régionale renforcée, le continent africain a le potentiel de revendiquer un rôle stratégique de premier plan dans l’économie mondiale de demain.