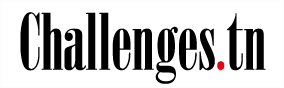Brexit : Une course d’obstacles, loin d’être terminée…
- Le Royaume-Uni n’est plus qu’à dix mois de la date officielle de son retrait de l’Union européenne, fixée au 29 mars 2019.
- L’incertitude politique reste particulièrement élevée, les accords conclus jusqu’ici demeurant imprécis sur des sujets d’envergure, comme le traitement réservé à l’Irlande du Nord.
- Difficile, dans ce contexte, de prévoir avec précision le scénario de sortie. En outre, le temps perdu sans avancée concrète amoindrit la probabilité d’un accord global satisfaisant pour toutes les parties.
- L’économie s’en trouve ralentie : la croissance est atone, dans un contexte de dépréciation de la livre sterling et de hausse de l’inflation.
- Ces conditions conduisent à une politique monétaire très prudente et retardent l’ajustement fiscal.
Le 23 juin 2016, 52% des Britanniques décidaient, par voie de référendum, de quitter l’Union européenne. S’en est suivi un changement à la tête de l’exécutif (Mme Theresa May remplaçant David Cameron au poste de premier ministre, à charge pour elle de conduire le Brexit) et une période de dissensions politiques profondes, dont le Royaume-Uni n’est toujours pas sorti.
Une course d’obstacles, loin d’être terminée…
L’article 50 du traité de Lisbonne est activé le 29 mars 2017, coup d’envoi de deux années de négociation en vue de préparer les modalités du divorce. Dans la foulée, portée par des sondages favorables, Theresa May planifie des élections générales anticipées pour juin 2017. Contre toute attente, elle en sort affaiblie et le parti conservateur doit s’allier au DUP (parti des unionistes d’Irlande du Nord) afin de maintenir une très courte majorité à la Chambre des Communes.
 C’est donc dans une position difficile que le Royaume-Uni aborde les discussions avec l’UE. De fait, dès le début du processus, et malgré les réticences britanniques, l’Union impose son calendrier qui comprend deux phases.
C’est donc dans une position difficile que le Royaume-Uni aborde les discussions avec l’UE. De fait, dès le début du processus, et malgré les réticences britanniques, l’Union impose son calendrier qui comprend deux phases.
La première détermine trois domaines, à savoir :
- Le montant du règlement financier dont le Royaume-Uni doit s’acquitter au titre des engagements pris vis-à-vis de l’UE
- Le statut des résidents européens au Royaume-Uni et des citoyens britanniques dans l’UE
- La situation de l’Irlande du Nord La deuxième phase, quant à elle, doit définir les contours du futur partenariat liant le Royaume-Uni à l’Union européenne.
Un accord incomplet sur les conditions de sortie
Deux accords (obtenus le 8 décembre 2017 et le 19 mars 2018) ont permis de fixer la durée, ainsi que les modalités, de la phase de transition. Celle-ci devrait commencer le 29 mars 2019 (date de sortie officielle) et s’achever le 31 décembre 2020 (date de sortie définitive correspondant à l’arrivée à échéance du budget européen pluriannuel 2014-2020). Le Royaume-Uni devra respecter, durant la période de transition, l’ensemble du droit européen ainsi que la compétence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sans, pour autant, pouvoir participer aux prises de décision des institutions, organes et organismes de l’UE. Il devra également appliquer automatiquement les modifications de l’acquis. Enfin, le Royaume-Uni, qui continuerait alors à participer au marché unique et à l’union douanière, devra respecter l’indivisibilité des quatre libertés du marché unique, à savoir la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, et se conformer à la politique commerciale de l’UE.
L’accord précise également les modalités de calcul du « chèque » que le Royaume-Uni signera à l’Union européenne lors de sa sortie. Il indique que les droits des résidents européens établis au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020, seront inscrits dans la loi britannique et protégés. Enfin, il affirme l’absence de frontière entre les deux Irlande, dans le respect des accords du Vendredi saint de 1998.
Le casse-tête irlandais
Le Royaume-Uni s’engage, en effet, à ce qu’aucune frontière physique ni aucun contrôle ou vérification ne soit mis en place entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. Une position alignée sur celle de la Commission européenne, qui propose comme alternative la création d’une zone règlementaire commune entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord, à charge pour cette dernière d’opérer les contrôles douaniers vis-à-vis du reste du Royaume-Uni. Problème, Mme Theresa May reste hostile à cette solution. Le gouvernement britannique, qui entend publier d’ici juin un « livre blanc », peine en réalité à clarifier sa position sur cette question. Plusieurs dispositifs sont actuellement à l’étude. Le « partenariat douanier », qui a les faveurs de la Première ministre, suppose que le Royaume-Uni perçoive à sa frontière, pour le compte de l’UE, les taxes et droits de douane sur les biens destinés aux Etats membres. Le Royaume-Uni pourrait dès lors décider seul de sa politique commerciale, tout en évitant l’installation de postes de douane entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord. Un tel dispositif peine cependant à convaincre en raison de sa complexité. Le développement, en seulement trois ans, d’une technologie capable de réaliser de tels contrôles semble hors de portée. Les partisans d’un Brexit « dur » jugent, par ailleurs, ce dispositif trop proche d’une union douanière. Ils lui préfèrent un « arrangement douanier simplifié ». Le Royaume-Uni ne formerait aucune union douanière avec l’UE, mais les contrôles douaniers entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande seraient limités grâce à une surveillance à distance des frontières. Toutefois, un tel dispositif irait à l’encontre de l’accord de paix pour l’Irlande du Nord de 1998 et donc des exigences de la Commission européenne. Celle-ci considère, par ailleurs, que ce dispositif butte, lui aussi, sur des contraintes techniques. La proposition britannique de maintenir une union douanière avec le reste de l’UE au-delà de 2021 offre une solution temporaire. Le Royaume-Uni et l’UE prendraient cependant le risque de voir cette situation durer.
Le futur hors de l’UE : le grand flou…
Le Royaume-Uni et l’Union européenne doivent parvenir à un accord de retrait définitif, d’ici octobre 2018, afin que le Conseil de l’UE, ainsi que les Parlements européen et britannique, puissent l’approuver d’ici la fin de la procédure de retrait, en mars 2019. Les négociations sur le futur traité de libre-échange ont commencé avec deux sessions, en mai et en juin 2018, avant un rendez-vous clé à la mi-juin 2018. Selon Michel Barnier, il existe aujourd’hui deux risques d’échec majeurs : la frontière entre les deux Irlande et la « gouvernance » de l’accord de retrait, qui ramène au rôle que la Cour européenne de justice aura à jouer dans les contentieux pouvant naître de la séparation.
Des dissensions existent aussi, et peut-être surtout, au niveau britannique lui-même. Jusqu’à présent, Mme Theresa May avait réussi à maintenir un équilibre fragile entre les différents courants, adversaires ou partisans du Brexit. Mais l’approche de l’échéance du 29 mars 2019 l’oblige à préciser ses choix, et cristallise les oppositions. Au sein de l’exécutif d’abord. Début mai, la Première ministre échouait ainsi à recueillir l’assentiment du gouvernement quant à son projet de « nouveau partenariat douanier » avec l’UE.
Avec le Parlement ensuite. Celui-ci a obtenu de voter l’accord de retrait et d’obliger l’exécutif à revenir à la table des négociations en cas de rejet de sa part ; depuis quelques temps, les deux Chambres sont le théâtre d’initiatives visant à contrer ou influencer la position du gouvernement. A la Chambre des Lords, l’opposition, soutenue par 24 députés conservateurs, a obtenu un vote majoritaire en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l’union douanière de l’UE. Un amendement dans ce sens a également été déposé à la Chambre des Communes. Le vote, qui doit avoir lieu prochainement, sera serré.
Vis-à-vis de l’Ecosse enfin. Le 15 mai dernier, le Parlement d’Edimbourg rejetait à une large majorité le « EU Withdrawal Bill », censé encadrer juridiquement la séparation d’avec l’UE.
 Un frein conséquent sur l’économie
Un frein conséquent sur l’économie
Un environnement économique fragilisé
Ces incertitudes politiques ont d’ores et déjà un impact important sur l’économie britannique. Dans un contexte de reprise mondiale, la croissance du pays serait à peine supérieure à 1% en 2018 et 2019, contre 2,1% et 1,9% pour l’ensemble des pays de l’OCDE. En outre, les prévisions pour le Royaume-Uni traduisent une tendance à la baisse et de fortes incertitudes pèsent négativement sur ces chiffres. La croissance du PIB n’a ainsi été que de 0,1% en volume au premier trimestre 2018. La demande intérieure faiblit. Depuis l’annonce du référendum en mai 2015, la livre s’est dépréciée de 18% en termes nominaux, renchérissant ainsi le prix des importations. L’augmentation de l’inflation qui en a résulté (elle est proche de 3%) a érodé le pouvoir d’achat des Britanniques, freinant la consommation privée. De manière générale, les indices Purchasing Managers’ Index (PMI) restent à des niveaux très bas, notamment dans l’activité manufacturière (plus bas niveau depuis 17 mois en avril) et les services (au plus bas en mars depuis juillet 2016).
Les enquêtes sur le moral des chefs d’entreprise révèlent une inquiétude croissante, en particulier dans les services (80% de la valeur ajoutée). Ces derniers constituent, en effet, l’une des rares sources d’excédents des échanges avec l’UE1. Le secteur immobilier, enfin, connaît un ralentissement. Si le taux de chômage reste bas (4,2%), la productivité du travail tend à marquer le pas. La concentration récente des emplois dans des secteurs à faible valeur ajoutée ou la faible accumulation de capital productif peuvent l’expliquer. Dans ce contexte, les restrictions attendues en matière d’immigration, ou encore l’inversion des flux d’investissements directs étrangers (graphique), sont plutôt mal venues.
 Une normalisation monétaire et fiscale retardée
Une normalisation monétaire et fiscale retardée
En novembre 2017, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, annonçait une normalisation « progressive et flexible » de la politique monétaire et décidait d’une hausse du taux de base de 0,25% à 0,50% (la première depuis 2007). La détérioration de la conjoncture au premier trimestre 2018 a toutefois condamné la possibilité d’une nouvelle hausse des taux en mai, contrairement à ce qu’avaient anticipé la plupart des investisseurs. Reconstruire une capacité d’intervention par le canal des taux d’intérêt en cas de nouvelles complications lors de la sortie effective du Royaume-Uni de l’UE reste donc un pari délicat. Les taux longs restent d’ailleurs exceptionnellement faibles, autour de 1,4% pour le taux à 10 ans des obligations souveraines. En parallèle, alors que la Réserve fédérale américaine a entamé la réduction de son bilan, celui de la Banque d’Angleterre devrait rester stable, à 435 milliards de livres. Il était jusque-là en régulière augmentation, sous l’effet des programmes de rachat d’actifs. La flexibilité s’applique aussi à la politique budgétaire. Avec un ratio de dette publique sur PIB proche de 87%, le Royaume-Uni est dans une situation comparable à celle de ses voisins européens. Comme eux, il devrait voir ce ratio se réduire dans les prochaines années. Cependant, le rythme devrait être ralenti par rapport à ce qui avait été initialement prévu. Alors que le gouvernement tablait encore, en mars 2016, sur un équilibre budgétaire pour 2019, celui-ci n’est désormais planifié que vers 2025.
Deux raisons principales expliquent ce changement : d’abord, la révision en baisse des projections économiques en raison du Brexit ; ensuite, le rejet de plus en plus manifeste des Britanniques de la politique d’économies budgétaires suivie depuis quelques années. Le Royaume-Uni est en effet, dans l’Union européenne, l’un des pays où le poids des transferts est le plus faible et a le plus reculé depuis 2010 (graphique 3). Face à certains effets, notamment sur l’éducation ou la santé, la majorité a pris le parti de réactiver quelques dépenses, mises en valeur par le gouvernement lors de la présentation de son budget en novembre dernier. Ainsi, 6,3 milliards de livres devraient être investis dans le système de santé nationale, tandis que les dépenses d’éducation augmentent également, avec plus de 70 millions de livres alloués à l’enseignement des mathématiques. En parallèle de ces mesures d’investissement, le gouvernement avait aussi fait un geste pour soutenir la consommation, via la hausse du revenu minimum ou le gel de certaines taxes. Ces mesures pourraient être poursuivies dans le prochain budget, notamment si la conjoncture demeure morose pour le pays.