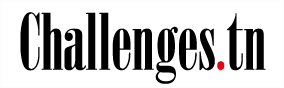La 26e édition du festival tunisois fait la part belle à la jeune génération de réalisateurs locaux, en passe de s’imposer dans un contexte économique et politique tendu.
Le macadam de l’avenue Bourguiba, témoin de toutes les manifestations depuis le soulèvement du 14 janvier 2011, se prépare à un autre grand rassemblement. Du 21 au 28 novembre, 150 000 cinéphiles, porteurs du slogan « Dialoguer, rêver, avancer… », vont envahir l’hypercentre de Tunis pour la 26e session des Journées cinématographiques de Carthage (JCC). Ils auront sept jours pour voir 300 films dont 17 longs-métrages de fiction, 16 documentaires, 15 premières œuvres et 13 courts-métrages en compétition officielle.
Depuis l’affiche en noir et blanc où ils trônent, les pères fondateurs en 1966 de la première manifestation consacrée au cinéma africain, Tahar Cheriaa et Ousmane Sembène, jubilent de voir leur utopie résister aux aléas politiques et mettre à l’honneur cette année « le cinéma du Sud indépendant et de qualité ». En cinquante ans, les problématiques quant aux perspectives commerciales de la production continentale n’ont guère changé. La question de la liberté d’expression et de l’engagement artistique est toujours autant d’actualité.
Avec un budget de 1,3 million d’euros, dont plus de la moitié est fournie par l’État tunisien, les JCC ont choisi cette année de faire fi de l’avis des conservateurs et des réactionnaires en projetant, pour la première fois en Afrique et dans le monde arabe, le film controversé de Nabil Ayouch, Much Loved. Un hommage sera rendu au réalisateur tunisien Nouri Bouzid, agréablement surpris par l’honneur qui lui est fait.
Humour Et les cinéphiles pourront découvrir l’émergence d’une nouvelle vague tunisienne avec Leyla Bouzid, Fares Naanaa, Maki Berchache et Kaouther Ben Hania, qui, selon le réalisateur Walid Tayaa, proposent des courts-métrages et des documentaires façonnés par des « univers et des regards nouveaux ».
Cette jeune génération, défendue par le nouveau directeur des JCC, Brahim Letaief, dit haut et fort ses préoccupations sociales.
Cette jeune génération, défendue par le nouveau directeur des JCC, Brahim Letaief, dit haut et fort ses préoccupations sociales. Brûle la mer, le documentaire de Maki Berchache et Nathalie Nambot, suit les élans contrariés des candidats à l’émigration clandestine nourris de rêve d’Occident et dénonce la violence de l’accueil qui leur est réservé.
Après les péripéties du Challat de Tunis qui décrivait avec humour une société où le corps féminin devient un enjeu politique tandis que les hommes peinent à trouver leur place, Kaouther Ben Hania suit avec Zaineb n’aime pas la neige une enfant qui grandit et mûrit dans une famille mixte et recomposée aussi corrosive que la harissa. Avec sa fiction À peine j’ouvre les yeux, Leyla Bouzid montre une jeune femme fascinée par le tourbillon de la vie, le rock et la nuit, et qui s’oppose inévitablement à ses parents.
La famille, ou plutôt le couple pris dans une descente aux enfers, est une thématique chère à Fares Naanaa. Après ses deux premiers courts-métrages, Casting pour un mariage et Qui a tué le prince charmant ?, il poursuit son introspection de la folle dualité du couple avec Les Frontières du ciel.
Crises, rejet, cassure, reconstruction sont des thématiques en apparence convenues, mais leur traitement est loin de l’être entre les dialogues décalés de Zaineb n’aime pas la neige et les plans très construits du film de Fares Naanaa. D’aucuns aimeraient que le septième art tunisien ose davantage, mais force est de constater qu’une écriture cinématographique différente par ses rythmes et ses lumières est en train de s’imposer. À suivre