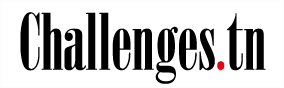Moez Labidi : «La privatisation des banques publiques pourrait déstabiliser le processus de restructuration déjà engagé»
(Interview réalisée par Imen Gharb)-La présence publique dans le secteur bancaire est au cœur du débat sur la restructuration bancaire, opposant les adeptes de la privatisation, à ceux favorables au maintien des banques publiques, sous la tutelle de l’Etat.
Ce débat fait rage suite aux déclarations de la ministre des Finances, Lamia Zribi, à « Reuters », selon lesquelles « plusieurs choix sont actuellement, à l’étude, à propos des 3 banques publiques, dont leur fusion, ce qui en vérité ne semble pas être réaliste…
Le dernier choix étant la cession de petites ou de grandes parts à des partenaires stratégiques ». La ministre avait ensuite, rectifié le tir, précisant à l’agence TAP, dimanche 26 février, que le gouvernement n’a pris aucune décision officielle au sujet des banques publiques qui connaissent un plan de restructuration…..
Dans une interview à l’Agence TAP, Moez Labidi, Professeur de Finance internationale considère qu’il n’y a pas de recette unique pour toutes les banques. L’heure des solutions « prêt-à-porter » est révolue, il plaide plutôt, pour des solutions sur mesure pour chaque banque.
L’idée d’une limitation de la présence publique dans le secteur bancaire a été dernièrement très présente dans les débats au sujet des banques publiques, quel est votre avis à ce sujet?
Dans un contexte marqué à la fois par l’ouverture de l’espace bancaire tunisien à la concurrence internationale et surtout le tarissement des sources de financement (internes et externes) du budget de l’Etat, la réflexion sur une stratégie de sortie de l’Etat des banques publiques s’impose.
Plusieurs facteurs ne cessent d’alimenter cette réflexion. Primo, la situation inquiétante des indicateurs des banques. Des records de taux de créances accrochées, des défaillances dans les systèmes d’information, une culture de risque quasi-absente, et une mauvaise gouvernance. Une situation qui s’est fortement dégradée avec le choc de la révolution et son cortège de détérioration des fondamentaux de l’économie tunisienne.
Secundo, une facture de recapitalisation de plus en plus salée, difficilement acceptable par l’opinion publique qui n’arrive pas à comprendre pourquoi c’est toujours le contribuable qui paye la facture de la mauvaise gouvernance du secteur bancaire public ? Difficilement acceptable aussi, à cause des finances publiques régulièrement criblées par le service de la dette et les revendications salariales excessives.
Tertio, l’incapacité du secteur bancaire public à soutenir des politiques de développement régional viables. Quarto, la marginalisation des PME par le secteur bancaire et la multiplication des barrières à l’entrée qui s’érigent devant l’accès de ces entreprises au crédit bancaire.
Enfin, le gap de performance qui ne cesse de se creuser aussi bien au niveau national (par rapport aux banques privées de la place) qu’au niveau régional (par rapport au secteur bancaire des pays concurrents, notamment le Maroc)
Toutes ces raisons expliquent le regain d’intérêt pour la question de la limitation de la présence de l’Etat dans le secteur bancaire.
Quel sort pour les banques publiques au regard de ces réflexions ?
Je pense qu’il n’y a pas de recette unique pour toutes les banques. L’heure des solutions « prêt-à- porter » est révolue. Pour que l’opération de restructuration devienne une opportunité à saisir et non un problème collatéral à gérer, il faut opter pour des solutions sur mesure pour chaque banque.
Pour les sept banques à participations non stratégiques (STUSID Bank, BTK, BTE, NAIB, BTL, Al Baraka et Banque Zitouna), l’Etat devrait céder ses participations. La concertation avec les autres pays partenaires serait déterminante pour trouver la solution la plus adaptée. Une telle cession pourrait être très bénéfique si elle s’inscrit dans une dynamique de concentration dans le secteur. Car l’atomisation du secteur bancaire tunisien s’est avérée néfaste aussi bien pour ce dernier que pour l’économie nationale. La sortie de l’Etat du capital serait aussi, profitable pour la place financière de Tunis si l’opération de cession de certaines de ces banques s’opère sur le marché boursier. Une opportunité pour corriger le manque de profondeur de ce marché.
Pour les banques opérant dans le champ des petites entreprises (BFPME) et de la micro-finance (BTS) l’heure est à la restructuration du paysage pour déboucher sur une fusion. Une fusion qui devrait toucher aussi la SOTUGAR. L’objectif est de réussir le lancement du projet, longtemps en stand by, à savoir celui de la banque des régions, une institution financière destinée à soutenir le développement régional.
Pour les trois grandes banques publiques, la question est plus délicate pour plusieurs raisons : leur poids dans le financement de l’économie, leur rôle dans le financement des entreprises publiques, le niveau élevé des effectifs et du coup, le coût social généré par toute opération de restructuration, leur caractère systémique, la sensibilité de l’opinion publique, …
Aujourd’hui, plusieurs scénarios sont sur la table des décideurs : la fusion, la privatisation, l’entrée d’un partenaire stratégique ou d’un partenaire technique.
Pour ce qui est de la fusion, les préalables ne sont pas réunis et l’expérience douloureuse de l’absorption de la BDET et de la BNDT par la STB, en 2000, est encore, présente dans la mémoire des tunisiens. Oui, l’économie tunisienne a besoin d’une banque de grande taille capable de financer les grands projets et d’accompagner l’entreprise tunisienne à l’étranger. Mais, se lancer dans un projet de fusion serait menaçant pour la stabilité financière si les préalables ne sont pas réunis (assainissement achevé, harmonisation des cultures d’entreprises, identification des synergies, ..). La fusion ne se décrète pas, elle doit émaner d’une dynamique de marché qui pousse des banques motivées par le rapprochement à rechercher des synergies de coûts (économie d’échelle) et de revenus, de diversification du risque ou d’élargissement de marché.
De même pour la privatisation, les préalables ne sont pas aussi réunis surtout pour la BNA et la STB. D’abord, la privatisation pourrait déstabiliser le processus de restructuration déjà engagé. Ensuite, elle serait interprétée comme une volonté de brader les deux banques à peine engagées dans une dynamique d’assainissement, pour éviter la valorisation attendue au terme du programme de restructuration, d’autant plus que les fonds engagés par l’Etat sont loin d’être négligeables (full audit « audit complet », recapitalisation, système d’information, programme de formation, nouveau système de rémunération, …). Enfin, elle pourrait bloquer le financement des entreprises publiques et des secteurs prioritaires, surtout que le contexte social n’est pas de tout favorable à ce type d’exercice.
Bref, avant de se lancer dans une dynamique de privatisation, il faut tenir compte de tous ces éléments pour garantir aussi, la réussite du processus de restructuration sur d’autres chantiers de réforme.
Comment se portent aujourd’hui ces banques après la recapitalisation et les réformes qui y ont été introduites ?
Certes, il est encore tôt pour observer de façon significative des signes d’amélioration des indicateurs de performance. Mais, il est certain que les trois banques n’ont plus besoin de l’argent du contribuable pour accomplir l’opération de recapitalisation, car une véritable dynamique d’assainissement s’est installée. La BNA est toujours en deuxième place sur les encours de crédits (+6,9% en 2016) et les dépôts (+11,2%). La STB occupe la quatrième place pour ce qui est des dépôts alors que la BH est en cinquième position (+12%) et enregistre une très nette reprise des crédits (+17,2%).
Le changement de la gouvernance commence à donner ses résultats. Il y a une détermination des équipes dirigeantes pour renouer avec les standards internationaux de bonne gouvernance et de performance. Certes avec des différences de rythme. La BH est aujourd’hui, en tête de peloton. Mais il ne faut pas oublier que le processus de restructuration a démarré avec trois ans de retard, dans les deux autres banques (STB et BNA).
Les contrats de performance des trois banques, portant sur la période 2016–2020, ont été évalués et appréciés par des experts internationaux. Ils visent à ramener le taux des créances accrochées des banques publiques de 23% aujourd’hui à 15% en 2020. Ce qui confirme une réelle volonté d’ancrage aux normes de performance et de bonne gouvernance. La STB n’est pas loin d’atteindre la totalité de ses objectifs de 2016, définis dans sa stratégie « STB 2020 » (99% de l’objectif pour le Produit Net Bancaire, 104% pour le Résultat Brut d’Exploitation, 98% pour les Dépôts de la clientèle .. ). Une performance honorable pour une banque qui continue de supporter à la fois l’épineux dossier des créances accrochées du secteur touristique et celui de la BFT.
Comment voyez-vous l’avenir du secteur bancaire public et pourra-t-il jouer son rôle de financement de l’économie comme il se doit au cours des prochaines années qui seront cruciales pour la relance économique ?
D’abord, le secteur bancaire public est toujours, en première ligne sur le front du financement de l’économie. Les trois banques sont toujours classées parmi les cinq premières pour ce qui est du financement de l’économie (BNA 2ème, BH 3ème, STB 5ème).
Il est nécessaire aujourd’hui, de rationaliser la présence de l’Etat dans certains segments du secteur bancaire (financement des TPE et des PME et micro-finance, financement de l’agriculture) et de favoriser la sortie de l’Etat du segment touché par la concurrence.
Du côté des autorités de tutelle, l’heure est à la fermeté dans l’application de loi, au courage pour améliorer le cadre juridique, afin de doter les banques publiques des outils facilitant la résolution des dossiers des créances accrochées, et à la prudence et au professionnalisme dans la définition du sequencing de la stratégie de sortie de l’Etat du secteur.
Car des réformes mal formulées peuvent devenir rapidement contreproductives. Nous sommes dans un contexte social miné par des attentes sociales croissantes et parfois démesurées, des enjeux électoraux et une surenchère revendicative, où le moindre faux pas pourrait stopper le processus de réforme pour plusieurs années aussi bien dans le secteur bancaire que dans d’autres chantiers (entreprises publiques).
Du côté des partenaires sociaux, l’heure est à la modération dans les revendications. Car le record enregistré par la masse salariale (14,4% du PIB) est à la fois honteux et étouffant. Honteux par l’effet d’annonce qu’il émet pour les investisseurs et les bailleurs de fonds internationaux et étouffant pour des finances publiques déjà sous pression. Rappelons que ce n’est pas la hausse des salaires qui va améliorer le pouvoir d’achat des ménages, mais plutôt l’amélioration des services publics (éducation, santé, transport, ..). Autrement dit, le pouvoir d’achat des ménages est aujourd’hui grevé par les dépenses résultant de la dégradation de ces services. Par exemple, une bonne réforme de l’enseignement public pourrait stopper le tsunami de l’«industrie de l’étude» et la ruée vers l’enseignement privé, et du coup, permettrait une amélioration significative du pouvoir d’achat des ménages.
TAP